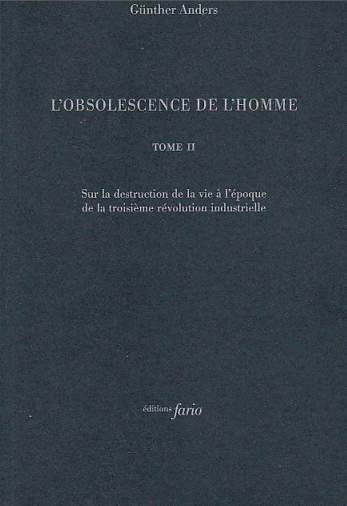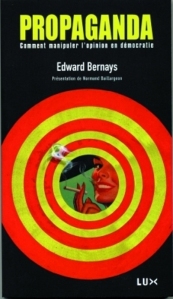Dans La Misère du monde, Patrick Champagne a consacré un chapitre à la représentation que les médias donnent des phénomènes dits de « banlieue » et il montre comment les journalistes, portés à la fois par des propensions inhérentes à leur métier, à leur vision du monde, à leur formation, à leurs dispositions, mais aussi par la logique de leur profession, sélectionnent dans cette réalité particulière qu’est la vie des banlieues, un aspect tout à fait particulier, en fonction de catégories de perception qui leur sont propres. La métaphore la plus communément employée par les professeurs pour expliquer cette notion de catégorie, c’est-à-dire ces structures invisibles qui organisent le perçue déterminant ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, est celle des lunettes. (…)
Le principe de sélection, c’est la recherche du sensationnel, du spectaculaire. La télévision appelle à la dramatisation, au double sens : elle met en scène, en images, un événement et elle exagère l’importance, la gravité, et le caractère dramatique, tragique. Pour les banlieues, ce qui intéressera ce sont les émeutes. C’est déjà un grand mot.. (…) Les journalistes, grosso modo, s’intéressent à l’exceptionnel, à ce qui est exceptionnel pour eux (…).

Pierre Bourdieu. Sur la télévision
Ils s’intéressent à l’extraordinaire, à ce qui rompt avec l’ordinaire, à ce qui n’est pas quotidien (…). D’où la place qu’ils accordent à l’extraordinaire ordinaire, c’est-à-dire prévu par les attentes ordinaires, incendies, inondations, assassinats, faits divers. Mais l’extra-ordinaire, c’est aussi et surtout ce qui n’est pas ordinaire par rapport aux autres journaux. C’est ce qui est différent de l’ordinaire et ce qui est différent de ce que les autres journaux disent de l’ordinaire, ou disent ordinairement. C’est une contrainte terrible : celle qu’impose la poursuite du scoop. (…)
Disposant de cette force exceptionnelle qu’est l’image télévisée, les journalistes peuvent produire des effets sans équivalents. La vision quotidienne d’une banlieue (…) n’intéresse personne.(…)
Les dangers politiques qui sont inhérents à l’usage ordinaire de la télévision tiennent au fait que l’image a cette particularité qu’elle peut produire ce que les critiques littéraires appellent l’effet de réel, elle peut faire voir et faire croire à ce qu’elle fait voir. Cette puissance d’évocation a des effets de mobilisation; elle peut faire exister des idées ou des représentations, mais aussi des groupes. Les faits divers, les incidents ou les accidents quotidiens, peuvent être chargés d’implications politiques, éthiques, etc. propres à déclencher des sentiments forts, souvent négatifs, comme la racisme, la xénophobie, la peur-haine de l’étranger et le simple compte-rendu, la fait de rapporter (…)- en reporter, implique toujours une construction sociale de la réalité capable d’exercer des effets sociaux de mobilisation (ou de démobilisation).
En imposant ces divisons, on fait des groupes, qui se mobilisent et qui, ce faisant, peuvent parvenir à convaincre de leur existence, à faire pression et à obtenir des avantages. Dans ces luttes, aujourd’hui, la télévision joue un rôle déterminant. Ceux qui en sont encore à croire qu’il suffit de manifester sans s’occuper de la télévision risquent de rater leur coup : il faut de plus en plus produire des manifestations pour la télévision, c’est-à-dire des manifestations qui soient de nature à intéresser les gens de télévision étant donné ce que sont leurs catégories de perception, et qui, relayées, amplifiés par eux, recevront leur pleine efficacité.
Pierre Bourdieu, Sur la télévision (1996), Liber-raisons d’agir, Paris, 1996.